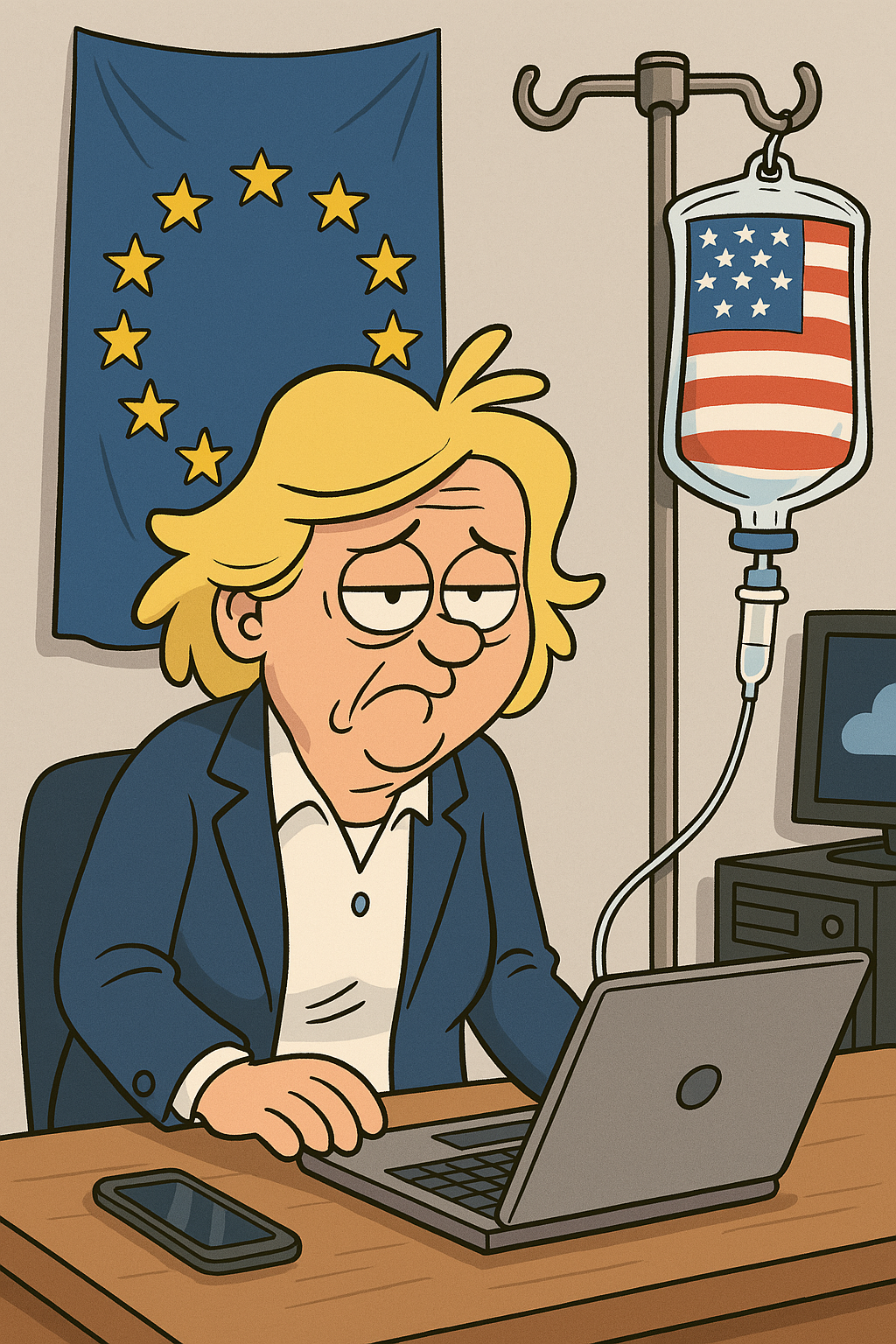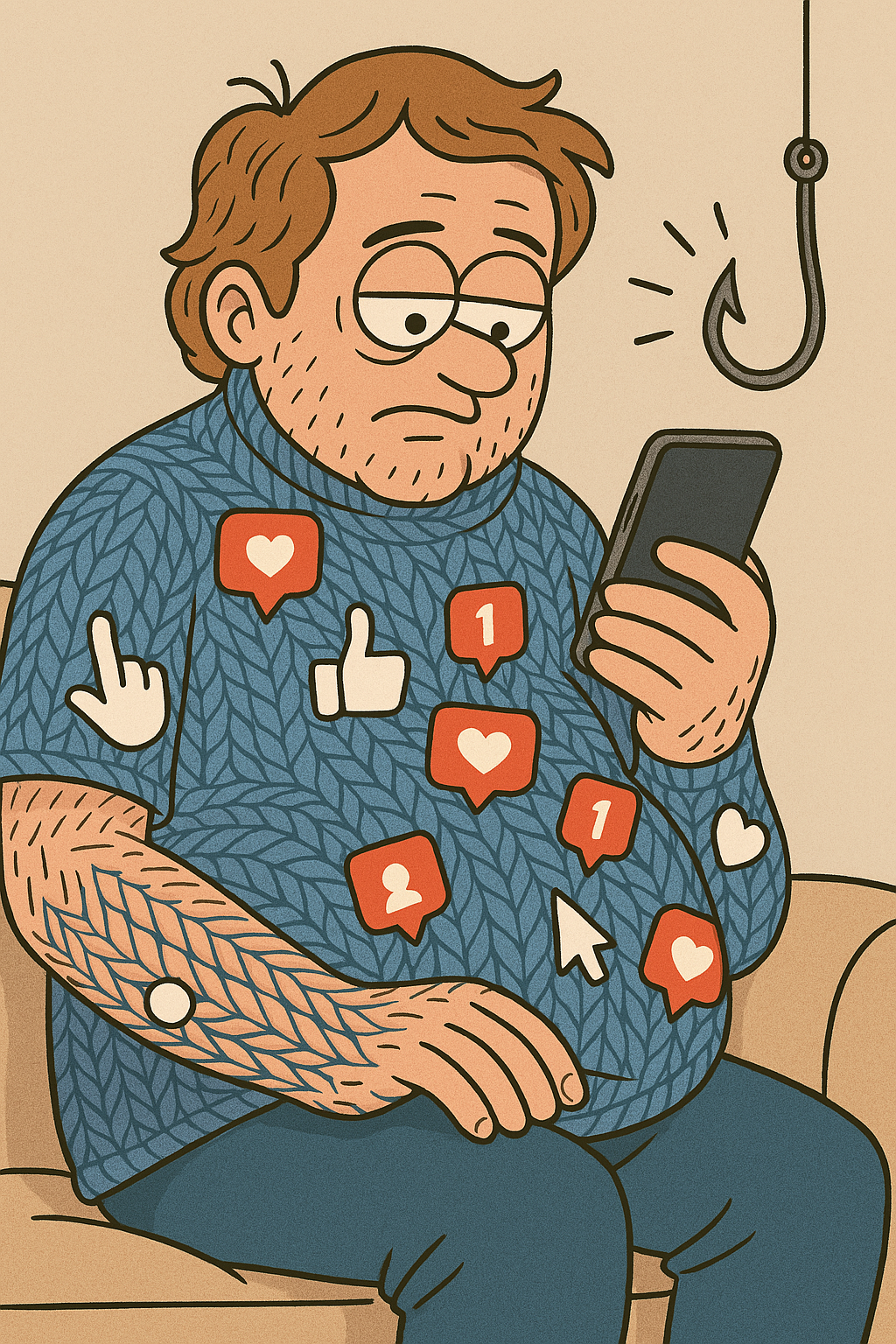#88 Il vaut mieux s'occuper du changement avant qu'il s'occupe de vous !
Europe, l’illusion de la souveraineté numérique Désarmer la science = une société sans cap ni contre-pouvoir Nous sommes nos clics Bienvenue dans le grand carnaval de la stupidité algorithmique


Bonjour à toutes et tous,
Au menu cette semaine :
Europe, l’illusion de la souveraineté numérique
Désarmer la science = une société sans cap ni contre-pouvoir
Nous sommes nos clics
Bienvenue dans le grand carnaval de la stupidité algorithmique
Bonne lecture.
Stéphane
Métamorphoses à l’ère de l’Intelligence Artificielle est en vente
Le livre Métamorphoses à l’ère de l’Intelligence Artificielle est en commande. Pour ce faire, il suffit de cliquer là.
Vidéo d’une conférence
J’ai le plaisir de partager avec vous la vidéo de ma dernière conférence, où j’explore entre autres l’écosystème de l’IA et l’évolution rapide des métiers. Dans ce talk, j’explique pourquoi comprendre les enjeux de l’IA, ses opportunités et ses côtés obscures. Nous devons tous être acteurs ! https://lnkd.in/gMYW5XDQ Je vous invite à visionner cette conférence et à me faire part de vos retours, questions ou expériences personnelles dans les commentaires. Ensemble, continuons à construire un futur où l'IA profite à toute l'humanité.
Europe, l’illusion de la souveraineté numérique
L’Europe aime se penser stratège, indépendante, souveraine. Pourtant, à l’heure où le code dicte la loi et où les réseaux numériques redessinent les rapports de force, elle ressemble davantage à un locataire précaire qu’à un propriétaire éclairé. Derrière ses discours sur la régulation et l’éthique, elle vit sous perfusion technologique américaine. L'intelligence artificielle, les infrastructures cloud, les réseaux sociaux, les systèmes d’exploitation : autant de briques fondamentales qui ne lui appartiennent pas.
En matière d’IA générative, les sept modèles les plus puissants en 2025 sont tous américains : GPT-4, Claude, Gemini, Nova, Grok, LLaMA et Mistral (à une nuance près : Mistral, seule start-up européenne dans la danse, dépend intégralement des puces Nvidia, des clouds américains pour entraîner ses modèles et de plus en plus de capitaux d’outre atlantique). Même l’accès à des alternatives comme Hugging Face passe par des serveurs hébergés aux États-Unis ou par des API tarifées en dollars. Côté cloud, le trio AWS (Amazon), Microsoft Azure et Google Cloud représente plus de 70 % du marché européen selon Synergy Research. Orange Cloud, OVH ou Deutsche Telekom ? Ils font de la figuration. Les rares services qualifiés de "cloud de confiance" en Europe… tournent sur des infrastructures américaines maquillées derrière des accords de licence. Quant aux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Android, iOS) et aux logiciels de productivité (Microsoft Office, Adobe, Salesforce), ils dominent sans partage les usages professionnels et administratifs. Résultat, même une réunion du Conseil de l’Union européenne ne peut se tenir sans faire transiter des données via des infrastructures made in USA. Sur les réseaux sociaux, le tableau est encore plus caricatural : Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), TikTok (contrôlé de très près par les États-Unis depuis la menace d’interdiction), YouTube et X (anciennement Twitter) dictent les flux d'information de plusieurs centaines de millions d'Européens. La régulation de Bruxelles (DSA, DMA) agit ici comme un pansement sur une fracture ouverte.
La conséquence de cette dépendance est double : technique d’une part, juridique de l’autre. Techniquement, l’Europe ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour entraîner des modèles d’IA à l’échelle de ceux de Google ou OpenAI. Elle ne possède ni les datacenters de très haute densité énergétique, ni les chaînes d’approvisionnement pour les GPU de dernière génération, ni l’écosystème de chercheurs et d’ingénieurs organisé autour de la recherche appliquée. Mais le plus préoccupant, c’est le sort des données européennes. Malgré le RGPD, nombre d’entre elles traversent l’Atlantique : logs de navigation, historiques de conversation, données d’usage, contenus créés par les utilisateurs. Le Cloud Act américain permet, depuis 2018, à Washington de réclamer à tout fournisseur US des données hébergées… n’importe où dans le monde. Autrement dit : même si un fichier est stocké dans un datacenter à Francfort, il peut être saisi légalement par une autorité américaine.
Imaginons maintenant deux scénarios, tous deux parfaitement plausibles si le contexte géopolitique se tend encore, par exemple après une montée des tensions transatlantiques.
Scénario 1 : L'interdiction d'export des puces d'IA vers l'Europe
Un matin, la Maison Blanche décrète un embargo total sur les puces Nvidia H100, Blackwell B200 et AMD MI300 vers les pays de l’UE, au nom de la "protection des intérêts nationaux". Résultat immédiat : tous les projets européens d’entraînement de modèles d’IA à grande échelle s’arrêtent net. Les start-ups ferment, les grands groupes suspendent leurs expérimentations, les chercheurs se retrouvent à travailler avec du matériel obsolète. Les alternatives ? Commande de puces chinoises moins performantes, développement de circuits maison (mais il faut dix ans et des dizaines de milliards), ou soumission pure et simple aux API américaines donc à leurs règles.
Scénario 2 : L’Europe privée d’écosystème numérique du jour au lendemain
Encore plus brutal : l’administration Trump impose que tout usage des services numériques américains par des entités européennes soit conditionné à la cession complète des droits d’exploitation des données aux entreprises US. Pas d’accord ? Alors plus d’accès à Microsoft 365, plus de Google Workspace, plus de Meta Ads, plus d’Android ou d’iOS. Les administrations doivent basculer dans l’urgence sur des systèmes open source immatures. Les entreprises voient leurs campagnes publicitaires s’arrêter, leurs CRM devenir inaccessibles, leurs outils internes tomber en panne. Un cauchemar qui révèle un fait simple : l’Europe ne tient que parce que Washington l’autorise à tenir.
Face à ces scénarios, continuer à miser uniquement sur la régulation serait une erreur stratégique. L’Europe doit cesser de croire qu’elle pourra arbitrer un jeu dont elle ne possède ni le ballon, ni le stade. Ce qu’il lui faut, c’est une stratégie industrielle radicale, inspirée du spatial ou du nucléaire : construire ses propres fabs, financer des alternatives à long terme, et surtout, abandonner la peur de l’échec entrepreneurial. À défaut, la souveraineté numérique restera un mirage et t l’Europe une simple dépendance technologique de l’Ouest plus spectatrice qu’actrice du siècle numérique.
Désarmer la science = une société sans cap ni contre-pouvoir
Alors que le monde s’enfonce dans l’incertitude climatique, géopolitique, technologique, … une dynamique à la fois discrète et radicale est à l’œuvre : le recul organisé de la recherche publique dans les grandes démocraties occidentales. Loin d’un simple effet collatéral de coupes budgétaires, cette érosion révèle une transformation structurelle du rapport au savoir, à la puissance et à la démocratie elle-même. Elle signe en creux une abdication stratégique au profit de nouveaux souverains à savoir les oligopoles du numérique.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes depuis une quinzaine d’années . Aux États-Unis, le financement fédéral de la recherche civile exprimé en pourcentage du PIB n’a jamais été aussi bas depuis les années 1950. Le National Institutes of Health, jadis fer de lance mondial de la recherche biomédicale, peine à suivre le rythme d’inflation scientifique imposé par les besoins contemporains. Le National Science Foundation, quant à lui, est contraint de rejeter plus de 75 % des propositions de projets pourtant jugés scientifiquement valables. La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne connaissent des dynamiques comparables : stagnation, précarisation, bureaucratisation. Dans ce climat de rareté programmée, la recherche devient l’objet d’une compétition interne acharnée où seuls les projets "bancables" survivent. Loin d’émanciper, cette logique assèche l’imagination scientifique.
En miroir de cet affaiblissement, on observe un mouvement inverse, massif et assumé à savoir l’essor exponentiel des investissements en R&D des grandes entreprises technologiques. Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, la galaxie d’Elon Musk et Apple consacrent des budgets annuels dépassant chacun les 30 milliards de dollars à la recherche. Pour donner un ordre de grandeur, cela équivaut ou dépasse les budgets nationaux de recherche de la plupart des États européens. Mais il ne s’agit pas seulement d’une différence d’échelle. Ce que finance la recherche privée, ce n’est pas le savoir en tant que bien commun mais l’innovation rentable. L’objectif n’est pas d’explorer, mais de breveter. Pas de comprendre, mais de transformer des modèles mathématiques en monopoles technologiques. On ne finance pas des recherches sur la thermodynamique des océans ou la linguistique comparée. On développe des interfaces neuronales propriétaires, des IA conversationnelles à but commercial, des outils de surveillance comportementale, ... Ce déplacement du centre de gravité de la production de savoir a deux conséquences majeures : une perte de pluralisme scientifique et un affaiblissement des contre-pouvoirs épistémiques.
Une chaîne de conséquences interconnectées
Réduire la recherche publique revient à compromettre une multitude de dynamiques que l’on croyait acquises. Le lien entre science et innovation économique n’est plus à démontrer : le GPS, Internet, l’IRM, les vaccins à ARN messager sont tous issus de laboratoires financés par l’État. Mais au-delà de l’économie, la recherche est le socle invisible de la résilience démocratique.
Sur le plan climatique, sans données indépendantes, pas de diagnostic fiable. Sans modélisation ouverte, pas de débat éclairé. L’appropriation privée des modèles prédictifs du climat introduit un biais systémique qu’est l’intérêt financier. Ce dernier privilégiera toujours l’adaptation technologique profitable à la réduction structurelle des émissions.
Sur le plan sanitaire, la pandémie de Covid-19 a révélé la dépendance croissante des États aux capacités d’analyse, de production et de modélisation d’acteurs privés. Moderna (dont le vaccin a été développé en grande partie grâce à des financements publics) a imposé ses conditions tarifaires aux gouvernements. Ce renversement du rapport de force est le symptôme d’un affaiblissement structurel de l’État chercheur.
Sur le plan politique, la production de connaissances devient un enjeu de pouvoir. Celui qui contrôle les données, les modèles, les outils d’analyse, contrôle l’interprétation du réel. Et lorsque la majorité des recherches en IA ou en neurosciences cognitives sont financées par des entreprises dont le modèle économique repose sur la captation de l’attention humaine, il y a lieu de s’inquiéter de la direction prise par la connaissance elle-même.
Depuis le XVIIe siècle, la science moderne s’est construite comme un projet collectif de dévoilement du réel indissociable de l’idée démocratique. Elle impose des procédures, des preuves et des validations croisées. Elle refuse l’arbitraire. C’est cette dimension que la recherche publique incarne. Une organisation du savoir soustraite aux logiques de marché et aux pulsions autoritaires. En la laissant dépérir, on ne fait pas que "réduire les dépenses publiques". On rend les sociétés plus vulnérables aux récits simplistes, aux fantasmes technosolutionnistes et aux manipulations de masse. Une société sans recherche indépendante est une société livrée aux marchands de vérités. Elle renonce à se penser elle-même.
Vers une recolonisation cognitive ?
Les grandes firmes technologiques deviennent des puissances cognitives. Elles décident de ce qu’il faut chercher, de la manière dont il faut le chercher et surtout de qui peut accéder aux résultats. Les publications open access deviennent payantes. Les jeux de données sont cloisonnés. Les outils d’IA sont distribués sous licences restrictives. Même les revues scientifiques jadis bastions du savoir académique tombent sous la coupe de consortiums commerciaux. Les États deviennent alors des clients. Ils achètent à prix d’or des solutions qu’ils auraient pu développer eux-mêmes. Ce que la puissance publique n’investit pas en amont, elle le paye dix fois plus cher en aval en perdant à la fois sa souveraineté, son influence et sa capacité d’action.
La bataille n’est pas perdue mais elle ne se gagnera pas avec des rustines. Il ne suffit pas d’ajouter quelques milliards au budget de l’Agence nationale de la recherche. Il faut repenser la place de la science dans nos sociétés et refonder un projet collectif autour du savoir, de l’exploration, de la lenteur et du doute. Cela suppose de redonner à la recherche publique les moyens non seulement de survivre mais de rayonner, de recréer des pôles de pensée et d’action qui ne soient pas sous tutelle algorithmique et de faire de la connaissance un commun politique et non une rente privatisée.
Autrement dit, il ne s’agit pas de sauver la science pour la science. Il s’agit de préserver ce qui, dans nos sociétés, résiste encore à la captation totale du monde par le marché.
Nous sommes nos clics
Il fut un temps où l’on définissait un individu par son nom, sa filiation, sa profession et peut-être sa signature. Ce sont aujourd’hui les miettes invisibles de nos vies numériques qui forment notre identité véritable. Non pas celle qu’on proclame à la face du monde, mais celle, souterraine, que les algorithmes chuchotent aux oreilles des géants du web. Notre ADN ? Une chaîne de préférences Spotify, d’achats compulsifs sur Amazon à trois heures du matin, de recherches Google maladroites tapées entre deux bâillements. À force de scroller, liker, swiper, nous avons tricoté sans le savoir une seconde peau. Une empreinte digitale invisible plus bavarde que notre bouche et plus fidèle que notre mémoire. Chaque clic est une confession. Chaque notification, un hameçon. Et nous mordons encore et encore.
Il y a quelque chose de vertigineux à penser que nos travers les plus dérisoires (ce petit tour quotidien sur les profils d’ex, la lecture frénétique de tweets politiques sans jamais voter, l’obsession pour les vidéos de cuisine qu’on ne réalisera jamais) en disent plus sur nous que mille heures de psychanalyse. Et pourtant, ce ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des addictions aux faux-semblants de contrôle, à la gratification instantanée et à la distraction chronique. On n’est plus maître de ses choix quand tout a été pré-mâché par des lignes de code. Plus besoin de réfléchir quand TikTok pense à notre place.
La question n’est plus ce que nous faisons d’Internet, mais ce qu’Internet fait de nous.
Alors faut-il diaboliser le numérique ? Certainement pas. Mais il serait temps de le regarder droit dans les yeux. Car il est devenu un miroir sans tain, cruel mais exact. Ce que nous y projetons est souvent trivial, parfois dérangeant et rarement noble. Et ce reflet collectif raconte une société en manque de silence, d’ennui et de profondeur. Nous scrollons pour ne pas penser. Nous cliquons pour ne pas ressentir. Nous rechargeons nos feeds comme on jette un filet dans l’océan en espérant attraper un peu de sens. C’est une boulimie d’interactions sans digestion possible.
Alors posez-vous la question. Que révèlent tes dix dernières recherches Google ? Quelle est la géographie émotionnelle de ton fil Instagram ? Que racontent tes cookies ? Certainement plus que votre journal intime oublié ! Nos habitudes numériques sont peut-être la forme la plus pure de notre inconscient moderne. Et ce qu’on y voit n’est pas toujours très reluisant. Mais il n’est pas trop tard pour reprendre la main. Pour désapprendre, désirer autrement, naviguer avec intention. Se souvenir que la liberté ne réside pas dans le choix entre 68 contenus mais dans le silence qu’on s’autorise à préserver.
Une étude publiée par Nature en 2023 a démontré qu’il est possible de prédire l’orientation politique d’un individu, sa santé mentale, voire sa sexualité, uniquement à partir de ses likes sur Facebook. Sans qu’aucune question ne lui ait été posée.
Pas besoin de vous connaître. Vos comportements parlent pour vous. C’est là que réside l’étrangeté moderne : plus on partage, plus on s’oublie. On confond authenticité et exhibition. Et plus nos données s’étalent, plus notre identité se dissout dans les algorithmes. Le paradoxe, c’est qu’on se croit unique alors qu’on devient statistiquement prévisible. Netflix sait à quel moment de l’épisode vous ferez une pause. Spotify anticipe votre humeur du lundi matin. Et Waze ajuste vos trajets en fonction de vos retards chroniques au bureau.
Sommes-nous encore libres de nos gestes quand chaque tentation a été placée là pour nous ?
Soyons honnêtes. Il ne s’agit plus seulement d’usages. Il s’agit de dépendances. De microshoots de dopamine à chaque notification. De cette pulsion étrange qui nous pousse à déverrouiller notre téléphone sans raison, juste pour vérifier… on ne sait même plus quoi. Peut-être l'existence.
Cette frénésie n’est pas neutre. Elle agit comme un bruit de fond qui nous empêche de penser. Le philosophe Byung-Chul Han parle d’“infobésité” et de “fatigue informationnelle”. À force de tout voir, on ne regarde plus rien. À force d’avoir accès à tout, plus rien n’a de goût. Nous vivons dans une société où le silence est devenu suspect et l’ennui presque honteux. Pourtant, c’est dans l’ennui que naît l’imaginaire.
Rien n’est figé. Il reste de l’espace, celui du choix, de la désobéissance douce et du silence volontaire.
Se reconnecter, oui. Mais à soi d’abord.
Bienvenue dans le grand carnaval de la stupidité algorithmique
On les appelle les AI slops. Un nom qui claque comme une insulte lancée à la figure du bon goût. Des vidéos absurdes, moches à en pleurer, générées par des IA dont la créativité ressemble à celle d’un enfant fiévreux sous LSD. Un exemple ? Un homme se transforme en araignée géante avant de muter en girafe. Flippant ? Non. Perturbant et regardé des centaines de millions de fois.
Il ne s’agit pas d’un simple bug de l’époque. C’est une véritable stratégie. On inonde les timelines, on repère les failles et on exploite chaque seconde d’attention pour engranger des vues, du clic, du cash. Pendant que l’humain suffoque sous la masse, les plateformes alimentent cette économie à coups d’outils de génération et d’API grande vitesse. Elles veulent du volume, pas du sens. Elles veulent du viral, pas du vrai. Le plus fou ? Ce contenu n’est même plus destiné à des êtres humains. Il parle aux robots, plaît aux algorithmes et caresse les courbes de performance. Et nous, coincés dans ce maelstrom visuel, on vacille. Nos repères fondent. La frontière entre réalité et délire numérique devient une flaque de pixels flous.
On pleure sur notre sort ? On baisse les bras ? Non. On relève la tête. Ces horreurs numériques nous montrent précisément où ça déraille. C’est une alarme. Il faut réapprendre à lire, à comprendre, à choisir, à trier le sens dans l’amas pour redevenir lucides.
L’intelligence artificielle va vite. Très vite. Mais nous avons un super-pouvoir que les machines n’auront jamais : la capacité de réinvention. On peut changer les règles du jeu. On peut détourner leur créativité folle pour bâtir autre chose. Parce que non, ce n’est pas « l’algorithme qui est fou ». C’est l’écosystème qu’on a laissé muter sans rien dire. Il est temps de reprendre la main et de redessiner un espace où l’IA élargit nos horizons au lieu de les noyer sous le bruit. Ça veut dire apprendre à filtrer et surtout à comprendre comment tout ça fonctionne. Devenons plus humain en valorisant l’intuition, l’émotion et l’éthique. L’IA peut produire à l’infini mais c’est à nous d’en faire quelque chose qui a du sens.
Les AI slops sont le symptôme d’un monde qui perd pied, pas la maladie. Nous pouvons encore influer cette tendance pour peu qu’on discute, explore et qu’on construise ensemble avec nos différences comme unique rempart contre l’uniformité virale.
Et puis voilà que débarque un cran au-dessus : le AI Brainrot est clairement toxique. Des vidéos immondes, racistes, sexuées à l’excès. Elles sont produites à la chaîne avec des outils comme Krea et Kling et vendues comme des recettes miracles sur Discord. Leur but ? Choquer. Faire grimacer. Car pour l’algo, toute réaction vaut de l’or même l’écœurement.
Et pendant ce temps-là ? Meta ferme les yeux. Tant que ça clique, tout va bien.
Bonnes métamorphoses et à la semaine prochaine.
Stéphane